Travailler ses forces et ses limites dans l’adoption
Travailler ses limites dans l’adoption est une question qui se pose de façon accrue.
Déjà parents, déjà adoptants, les référents d’Enfants en recherche de famille ont généralement l’expérience au quotidien de l’adoption des enfants à besoins spécifiques.
Avec recul et sans jugement, ces « jardiniers » des chemins de l’adoption accueillent les désirs de chacun, célibataire ou en couple, et accompagnent les postulants qui s’orientent vers l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques, dans un travail autour de leurs limites et de leurs forces.
Par Sandrine et Jean-Louis Vercasson, anciens référents ERF
Ne pas « dépasser les bornes de ses propres limites »
« Tu as dépassé les bornes des limites, Maurice ! » Peut-être vous souvenez-vous de cette publicité. Ne pas « dépasser les bornes de ses propres limites » : voilà ce à quoi nous nous efforçons avec les postulants. Nous avons tous nos limites, nées de nos histoires, de nos personnalités et de nos représentations.
Cerner et identifier ses limites
La première démarche dans un projet d’adoption d’enfant à besoins spécifiques est certainement de pouvoir les cerner, les identifier et les nommer sans se juger soi-même ou se sentir jugé. Les postulants ne sont pas appelés à devenir des « parents universels », taillés pour accueillir n’importe quelle situation. Ils sont appelés, si leur démarche doit aboutir, à devenir les parents de leur(s) enfant(s). Pour aller vers cet ou ces enfants qui seront les leurs, il leur faut travailler à cerner quels parents ils peuvent être, il leur faut se projeter.
Accepter de « perdre du temps »
Notre premier rôle de référents ou personnes ressources ERF consiste à inviter les postulants à accepter de « perdre du temps » à ce travail autour de leurs limites et de leurs forces. Pour pouvoir les aider à avancer sur ce chemin, la confiance établie avec eux est bien sûr capitale. Il faut qu’ils acceptent de baisser un peu la garde. Jamais facile, mais un peu moins difficile peut-être quand on sait que l’on a affaire à quelqu’un qui a déjà parcouru ce même chemin auparavant.
Clarifier et développer son projet parental
Avant de commencer un jardin, il s’agit de le délimiter, de le défricher, de préparer la terre. Dans le « champ de l’adoption », il en est certainement de même. Définir les limites de son projet parental ne le réduit pas mais le clarifie et lui permet de se développer avec sérénité. Déterminer où l’on ne peut pas ou ne souhaite pas aller permet d’éviter autant que possible de se mettre en difficulté, voire en danger, et surtout de mettre en danger un ou des enfants dont le parcours a déjà connu difficultés et ruptures.
Identifier ses ressources
Définir ses limites, c’est en parallèle identifier ses ressources, laisser éclore ses ouvertures, en pleine connaissance de cause… et parfois en découvrir d’inattendues. Pour un nombre non négligeable de postulants que nous rencontrons, cette question des limites, des points forts et des « faiblesses » a été peu abordée – ou peu creusée. Le travail d’accompagnement consiste alors à « déplier » tous les aspects de la démarche, à imaginer ou, mieux encore, à se projeter de manière concrète dans telle ou telle situation. Le fait de pouvoir mener cette réflexion pendant la démarche d’agrément – ce qui est parfois le cas – constitue certainement un plus. Les fruits peuvent alors en apparaître dans les enquêtes et la notice.
De quelles limites parlons-nous ?
Pour chacun, pour le couple
Il s’agit bien sûr des limites personnelles et intimes de chaque postulant. Avec quelles situations nous sentons-nous en empathie ? Pathologies, évolutives ou non, handicap moteur, sensoriel, mental, enfants grands aux parcours de vie difficiles ?
Il s’agit aussi des limites du couple lorsqu’il s’agit d’une démarche de couple. Ce que l’un des deux se sent capable d’assumer et de vivre peut paraître « hors limite » à l’autre qui n’ose pas forcément le formuler devant l’enthousiasme de son conjoint.
Les enfants déjà présents et la famille élargie
Il y a aussi régulièrement les enfants déjà là, avec la limite évidente de ne pas mettre en danger la famille existante. Sans oublier de prendre en compte la famille élargie et l’entourage : l’enfant n’arrive pas dans une maison dont les portes sont fermées sur l’extérieur. Il faut également prendre en compte le milieu et les conditions de vie : contraintes matérielles liées à l’insertion géographique, éloignement des structures de santé, configuration du lieu d’habitation, disponibilité et obligations professionnelles…
On ne peut jamais tout imaginer mais…
Il y a les limites à considérer dans chaque démarche d’adoption d’un enfant à besoins spécifiques : parents, nous ne serons pas les « sauveurs » de l’enfant, nous ne pourrons pas tout « réparer », et nous pourrons, par moments avoir besoin d’une extérieure, familiale ou amicale, mais aussi professionnelle. Autant d’aspects à envisager, de questions auxquelles confronter les postulants. Bien sûr, on ne peut jamais tout imaginer, tout prévoir, : nos limites et nos forces se révèlent souvent « à l’épreuve du feu » quand nous sommes bousculés, mais prévoir ce qui peut l’être, n’est-ce pas se laisser toutes les chances de mieux « gérer » l’imprévu ?
Comment aider les postulants à clarifier leurs limites et leurs ouvertures ?
Comment les aider à se projeter, à mettre « de la chair » sur leurs désirs, leurs attentes et à confronter ces désirs et ces attentes à leurs points forts et leurs fragilités ?
Des éléments d’informations
D’abord en leur donnant des éléments d’information sur les différents types de particularités, en insistant sur les implications concrètes au quotidien (contraintes matérielles, suivi médical ou autre, disponibilité…). Se projeter dans le concret permet de confronter les représentations de chacun au réel et de mettre au jour bien des limites. Nous ne pouvons évidemment pas fournir une information exhaustive. Aborder cet aspect est, pour eux, une invitation à s’informer, à chercher et à creuser. Nous pouvons les orienter vers des sources d’informations, des ressources qu’ils devront exploiter eux-mêmes. Cela fait partie de la démarche. Nous leur suggérons une paire de lunettes à chausser : qu’est-ce que cela impliquerait concrètement dans notre vie quotidienne ?
Mettre le fruit de ses réflexions par écrit
Pour les couples
Nous invitons les postulants à mettre le fruit de leur réflexion par écrit, de manière séparée dans un premier temps quand il s’agit d’un couple. Chacun inscrit dans une colonne ses « oui » (ce qu’il se sent capable d’assumer sans hésitation), dans une autre ses « non » (ce qui dépasse ses limites sans hésitation), et dans une troisième ses « ? » (ce qui reste en question). La confrontation des deux grilles n’a lieu qu’après. Les « oui » communs deviennent des « oui » du couple, le « non » de l’un des deux devient le « non » du couple, sans discussion ni négociation, et les points d’interrogation deviennent discussion.
Un exercice plein de surprises
Cet « outil » nous semble intéressant dans la mesure où ce qui est écrit est écrit. On peut dans la discussion s’influencer ou ne pas oser refroidir l’enthousiasme de l’autre. Ce qui a été exprimé par écrit reste, personne ne s’efface et une vraie discussion peut alors avoir lieu. Cet exercice peut se révéler plein de surprises : on peut penser savoir ce que pense l’autre, ou même penser à sa place… et se tromper lourdement.
Pour les célibataires
Quand il s’agit de postulants célibataires, nous les invitons à faire cet exercice avec un ou deux de leurs meilleurs amis, avec quelqu’un qui les connaît bien, et d’en parler avec eux, non pas comme avec un conjoint qui est appelé à devenir le parent de cet enfant, mais comme avec quelqu’un qui aura le cas échéant une place privilégiée dans l’environnement immédiat de la cellule familiale toute neuve.
L’adoption n’est pas une démarche intellectuelle
Nous invitons les postulants à identifier et laisser s’exprimer leurs sentiments, leurs peurs, leurs angoisses, leurs désirs… parce que, dans cette démarche, tout n’est pas de l’ordre du rationnel. L’adoption n’est pas une démarche intellectuelle. Aller sur le terrain de ses limites émotionnelles, les exprimer et les accepter sans pouvoir toujours les expliquer ne rend pas la démarche moins raisonnable ! Au contraire peut-être !
La question de l’incertitude
Nous insistons sur un point essentiel, selon nous, d’un projet vers un enfant à besoins spécifiques : la question de l’incertitude. Comment nous situons-nous face à l’inconnu, l’imprévu ou l’incertitude ? Nous sentons-nous armés pour accepter de ne pas savoir vraiment où nous allons ? Saurons-nous demander de l’aide sans nous sentir incapables, sans nous juger dans nos capacités parentales ? Là encore, il ne s’agit nullement de juger la démarche. Il n’y a pas de « super postulants Zorro de l’adoption » qui affronteraient toutes les incertitudes, et de « petits postulants lambda » au projet resserré. Toutes sont des démarches uniques, légitimes et respectables. Il s’agit seulement de clarifier sa route.
La question de la disponibilité
Nous utilisons aussi l’outil bien connu du camembert du temps. Outil utile pour se projeter dans le concret de la vie. Inviter les postulants à identifier comment se répartit leur temps sur une semaine à l’heure actuelle et les inviter à projeter l’arrivée d’un enfant à besoins spécifiques dans cet emploi du temps établi, et appelé à être bouleversé. C’est là qu’intervient à nouveau le travail d’information sur les besoins spécifiques : en fonction de tel ou tel projet et des implications concrètes, que pouvons-nous envisager avec sérénité ? Où trouverons-nous le temps nécessaire à l’accueil et à l’accompagnement dont aura besoin cet enfant ?
Un champ à préparer
Se connaître en tant que parents potentiels
Voilà ce qu’est ce temps de préparation et d’accompagnement : un temps pour se connaître en tant que parents potentiels, et parfois se découvrir. Paradoxalement, réfléchir à ses limites, les identifier et les nommer ouvre l’horizon. Clôturer le champ permet de le cultiver en sécurité, pour ceux qui cultivent et pour ce qui est amené à y pousser… en acceptant bien sûr que la clôture puisse bouger au fil du temps : un projet d’adoption est un projet vivant dont les contours peuvent évoluer au fil de l’attente. Toutes les questions ne sont pas tranchées une fois pour toutes ! Cela s’accompagne aussi.
Des jardiniers un plus anciens…
Référents ERF, nous ne sommes finalement que des jardiniers un peu plus anciens qui, modestement mais avec conviction, veulent aider les postulants à baliser leur terrain et à trouver la bonne terre pour faire éclore leur projet familial, avec nous aussi nos limites et nos points forts !
Loin de nous en tout cas l’idée de donner les limites, de dire aux postulants ce qu’ils ont à accepter ou à refuser. Intervenants parmi d’autres dans cette démarche d’adoption, notre ambition, elle aussi limitée, est d’aider les postulants à se poser quelques bonnes questions… surtout pas de répondre à leur place. C’est à eux qu’il revient de faire le « travail » d’accouchement !
À lire sur ce blog
- Sandrine et Jean-Louis Vercasson, La disponibilité parentale en question
À lire dans la revue Accueil
- Accueil n° 192, « Les limites dans l’adoption », septembre 2019
Dans l’adoption, la question des limites se pose de façon accrue. Avant l’adoption, pour définir les limites et les contours de son projet : jusqu’où puis-je aller ? De quel enfant pourrai-je (ou pas) être le parent ? Âge, santé, histoire : que puis-je accepter ou ne pas accepter ? Ces limites peuvent éventuellement évoluer : comment cette évolution s’accompagne-t-elle ? Devenir enfin parent, c’est aussi fixer des limites à son enfant. Si, dans la parentalité biologique, le développement de l’enfant permet la succession progressive des étapes, dans la parentalité adoptive tout se bouscule, en particulier quand l’enfant arrive « grand ».



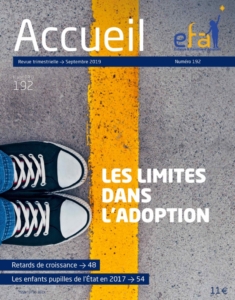
 iStock/Strekalova
iStock/Strekalova